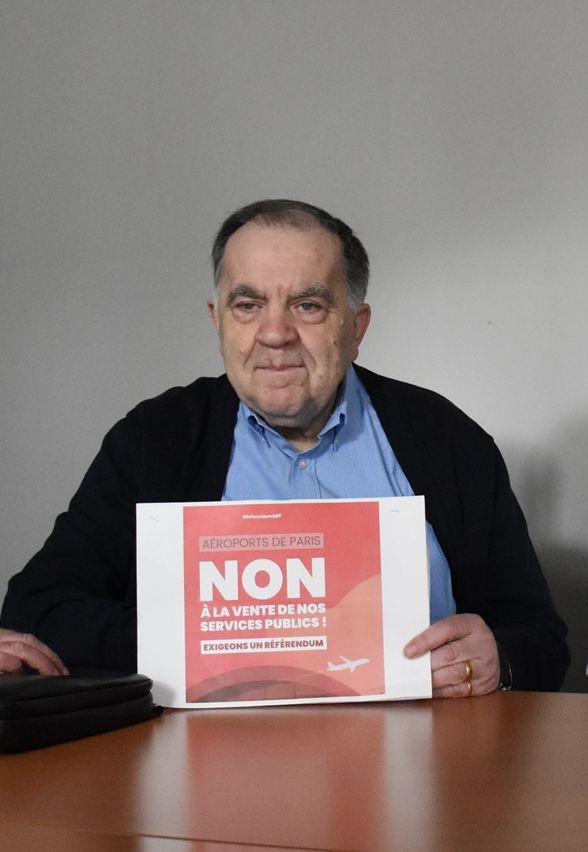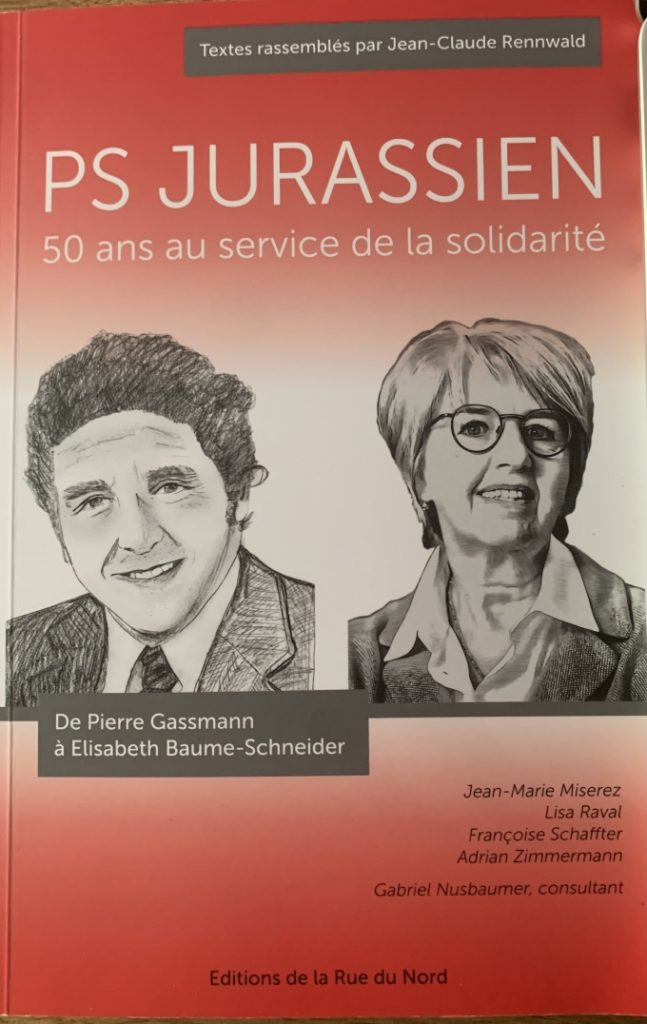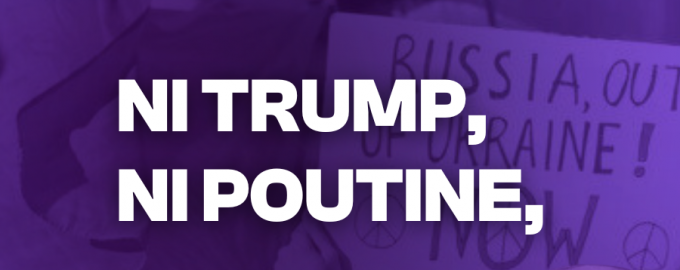Retour sur les grèves de novembre-décembre 1995
J’ai écrit cet article pour le numéro de novembre de la revue Démocratie&Socialisme à propos du 30ème anniversaire des grèves de novembre-décembre 1995. J’ai évidemment utilisé le travail que j’ai effectué il y a quelques mois pour écrire un ouvrage centré sur la grève à la SNCF à Nantes (disponible au Centre d’histoire du travail).
Il y a trente ans, le pays se mobilisait aux cris de « Tous ensemble, tous ensemble » (à l’origine scandé par les supporters de matchs de football). Cela fut le plus grand mouvement de grèves et de manifestations depuis 1968. Le plan Juppé, mais aussi le contrat de plan État-SNCF ont été les deux ingrédients d’une des dernières grèves d’ampleur nationale à avoir fait reculer (au moins partiellement) un gouvernement en France.
Le contexte
Le patronat français n’a jamais accepté une Sécurité sociale basée sur des cotisations, et gérée par les représentants des salariés. Depuis les ordonnances gaullistes de 1967, toutes les droites ont cherché à étatiser la Sécu. Le plan Juppé a accéléré ce mouvement, en affaiblissant encore le rôle des syndicats dans sa gestion. Juppé a voulu en profiter pour attaquer la retraite des fonctionnaires (allongement de la durée de cotisations de 37,5 à 40 années ) et pour supprimer les régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF-GDF…).
En mai 1995, Jacques Chirac a été élu sur la réduction de la « fracture sociale ». Pourtant le 26 octobre suivant il explique qu’il a « sous-estimé l’ampleur des déficits ».et annonce vouloir réduire ces déficits « pour qualifier la France pour la monnaie unique européenne ». Dans ce contexte le plan Juppé est présenté le 15 novembre à l’Assemblée nationale pour réduire le soi-disant « déficit » de la Sécurité sociale. Applaudi par une majorité de députés, ce plan est très vite rejeté dans l’opinion publique.
Parallèlement, l’État préparait un contrat de plan État-SNCF. La priorité mise en avant est de réduire le déficit de l’entreprise publique de chemins de fer (dû notamment aux investissements dans les lignes nouvelles depuis les années 70-80). On parle d’une suppression possible de 6000 kilomètres de ligne !
Dès le mois d’octobre, l’agitation commence dans les facultés. Souvenons-nous qu’en 1994, la jeunesse avait eu la peau du Contrat d’insertion professionnelle (CIP), un contrat pour les moins de 26 ans, mais rémunéré à 80 % du SMIC. En 1995, cette fois c’est le manque de moyens pour les facs qui est dénoncé.
Le gel des salaires dans la fonction publique et dans le secteur public alimente le mécontentement.
Lire la suite…